Faire estimer gratuitement des pièces d'orfèvrerie et d'argenterie

L'orfèvrerie et l'argenterie sont des formes d'art qui ont une longue histoire et qui ont toujours été appréciées pour leur beauté, leur qualité et leur valeur. Ces pièces sont souvent fabriquées à partir de métaux précieux tels que l'or, l'argent et le bronze, et sont souvent ornées de pierres précieuses, de motifs complexes et de gravures fines.
De par leurs différentes manufactures, orfèvres et poinçons, les pièces d'orfèvres doivent être présentées à un commissaire-priseur agréé.
Réponse en - de 24h
Histoire de l'orfèvrerie et de l'argenterie
L'orfèvrerie et l'argenterie ont une longue histoire remontant à l'Antiquité. Les artisans de l'époque produisaient souvent des pièces pour les temples, les palais et les riches propriétaires fonciers. Au Moyen Âge, la production d'orfèvrerie et d'argenterie est devenue plus courante, et ces pièces étaient souvent utilisées pour des cérémonies religieuses, des banquets et des événements sociaux importants.
Au XVIIIe siècle, l'orfèvrerie et l'argenterie ont connu un âge d'or avec des manufactures renommées telles que la manufacture de Sèvres en France et la manufacture de Meissen en Allemagne. Ces manufactures ont produit des pièces célèbres telles que des services de table, des vases et des figurines. Au XIXe siècle, l'orfèvrerie et l'argenterie ont continué à être produites en quantités importantes, avec des manufactures telles que Tiffany & Co. aux États-Unis, produisant des pièces de grande qualité.
Comment authentifier les poinçons d'orfèvres?
Les poinçons d'orfèvre sont des marques apposées sur les pièces d'orfèvrerie pour indiquer leur origine, leur date de fabrication, la qualité de l'argent ou de l'or utilisé, et l'orfèvre ou la manufacture qui les a produites. Ces marques sont très importantes pour l'authentification et l'estimation des pièces d'argenterie ou de joaillerie.
Pour reconnaître un poinçon d'orfèvre, il est important de se référer à un guide de poinçons, qui répertorie les différents symboles et marques utilisés par les orfèvres et les manufactures à travers l'histoire. Ce guide peut être consulté en ligne, dans des livres spécialisés ou auprès d'experts en orfèvrerie, comme les commissaire-priseur.
Les poinçons d'orfèvre sont généralement composés de plusieurs éléments, tels que des lettres, des chiffres, des symboles et des marques d'Etat. Ils sont souvent inscrits sur des parties discrètes des pièces, comme le fond d'un plat, l'intérieur d'un couvercle, ou sur la bélière d'un bijou.
Il est important de noter que les poinçons peuvent varier en fonction de la région, de l'époque et du style de la pièce. Il est donc important de prendre en compte tous ces éléments pour déterminer l'origine et la valeur d'une pièce d'orfèvrerie.
Enfin, il est conseillé de faire appel à un expert en orfèvrerie ou un commissaire-priseur pour authentifier et estimer une pièce d'argenterie ou de joaillerie, en prenant en compte les différents éléments, tels que les poinçons, la qualité des matériaux et le style de la pièce.
Réponse en - de 24h
Les plus grands orfèvres qui ont marqué l'histoire
L'orfèvrerie est un art millénaire qui a connu de nombreux maîtres à travers les siècles. Parmi les plus célèbres, on peut citer Jean Deprès, un orfèvre français qui a marqué l'histoire de l'Art Déco. Il a créé des bijoux et des objets d'art modernes et audacieux, avec des designs épurés et géométriques. Ses œuvres sont très prisées des collectionneurs, et peuvent atteindre des prix élevés en vente aux enchères. Par exemple, une paire de boucles d'oreilles en or et diamants, créées par Deprès dans les années 1930, a été vendue pour près de 40 000 euros en 2017.
J.J. Kirstein est un orfèvre américain qui a produit des pièces d'argenterie sophistiquées et élégantes. Il a travaillé pour de nombreux clients fortunés de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, comme la famille Vanderbilt. Ses pièces sont très appréciées des collectionneurs d'art et d'antiquités, et peuvent atteindre des prix élevés en vente aux enchères. Par exemple, un ensemble de couverts en argent sterling créé par Kirstein en 1895, a été vendu pour plus de 7 000 dollars en 2019.
Jean-Frédéric BRUCKMANN est un orfèvre allemand du XVIIIe siècle, connu pour ses pièces d'argenterie rococo et baroques. Ses œuvres sont très rares et très recherchées des collectionneurs, et peuvent atteindre des prix très élevés en vente aux enchères. Par exemple, un plat en argent de Bruckmann, datant de 1737, a été vendu pour plus de 31 000 euros en 2014.
Thomas Germain est un orfèvre français du XVIIIe siècle, qui a produit des pièces d'argenterie élégantes et décoratives. Ses œuvres sont très prisées des collectionneurs, et peuvent atteindre des prix élevés en vente aux enchères. Par exemple, une paire de candélabres en argent créés par Germain en 1759, a été vendue pour plus de 180 000 euros en 2012.
Martin Guillaume Biennais est un orfèvre français du début du XIXe siècle, connu pour ses pièces d'argenterie Empire. Il a travaillé pour Napoléon Bonaparte et d'autres membres de la famille impériale française, créant des pièces d'argenterie élégantes et sophistiquées. Ses œuvres sont très recherchées des collectionneurs, et peuvent atteindre des prix élevés en vente aux enchères. Par exemple, un plateau en argent de Biennais, datant de 1806, a été vendu pour près de 80 000 euros en 2016.
Jacques Roettiers est un orfèvre français du XVIIIe siècle, qui a créé des pièces d'argenterie rococo et baroques. Ses œuvres sont très rares et très recherchées des collectionneurs, et peuvent atteindre des prix très élevés en vente aux enchères.
A quel prix peuvent se vendre les pièces d'orfèvrerie et d'argenterie ?
Les prix des pièces d'orfèvrerie et d'argenterie peuvent varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, tels que la rareté, l'âge, la qualité de l'argent, la taille, la marque ou le fabricant, et l'état de conservation. Certaines pièces très rares ou historiques peuvent atteindre des prix très élevés, allant de plusieurs dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros en vente aux enchères. Cependant, la plupart des pièces ont des prix plus abordables et peuvent être trouvées à des prix allant de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Il est important de faire estimer une pièce d'argenterie par un expert avant de la vendre.
Quelques exemples des meilleurs résultats aux enchères
- Un service de table en argent massif de 88 pièces, créé par la manufacture française Puiforcat, vendu pour plus de 120 000 euros en 2018.
- Une paire de bougeoirs en argent et cristal de Baccarat, créés par la maison française Christofle, vendue pour près de 50 000 euros en 2019.
- Un plateau en argent massif de la maison allemande Bruckmann, datant de 1737, vendu pour plus de 31 000 euros en 2014.
- Un vase en argent massif de la maison anglaise Paul Storr, créé en 1812, vendu pour plus de 50 000 euros en 2019.
- Un centre de table en argent massif de la maison française Odiot, créé en 1908, vendu pour plus de 10 000 euros en 2017.
- Une paire de candélabres en argent massif de la maison française Germain, datant de 1759, vendue pour plus de 180 000 euros en 2012.
- Un service de thé et café en argent massif de la maison américaine Tiffany & Co., vendu pour plus de 70 000 dollars en 2017.
- Une bague en or et diamants de la maison italienne Bulgari, vendue pour près de 20 000 euros en 2019.
- Un plateau en argent massif de la maison française Biennais, datant de 1806, vendu pour près de 80 000 euros en 2016.
- Une broche en or et émeraudes de la maison française Van Cleef & Arpels, vendue pour plus de 60 000 euros en 2018.
Réponse en - de 24h
A découvrir dans la même thématique
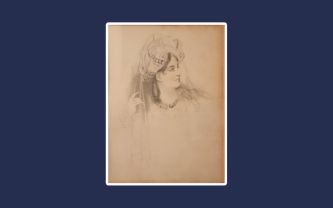
Cote et valeur des dessins orientalistes
Cette semaine, une de nos lectrices soumet à notre commissaire-priseur, Céline Beral, un dessin réalisé au crayon de papier, avec quelques rehauts ros
En savoir plus >

Cote et valeur 2024 des vases en porcelaine de Sèvres
Les vases en porcelaine de Sèvres sont des objets particulièrement appréciés et recherchés sur le marché des enchères. Leur cote est haute.
En savoir plus >

Cote et valeur des services en porcelaine Hermès
Les services en porcelaine Hermès sont des objets prisés qui ont peuvent avoir beaucoup de valeur aux enchères; selon le modèle et la rareté.
En savoir plus >
Site sécurisé, anonymat conservé
Commissaire-priseur et expert agréé par l'État
Estimations gratuites et certifiées

